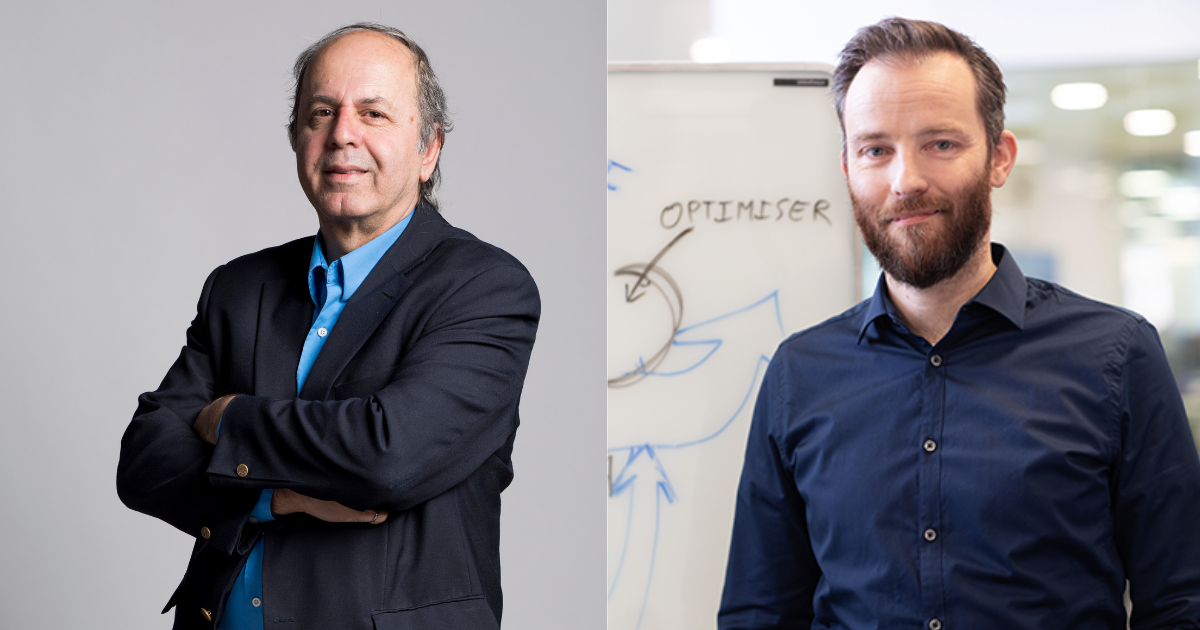En raison des changements climatiques, les zones côtières peuvent s’attendre à une élévation du niveau de la mer ainsi qu’à une augmentation en fréquence et en gravité de phénomènes extrêmes comme des ouragans, des tsunamis, des inondations… Dans ce contexte on ne peut plus dynamique comment adapter nos ouvrages et les façons de les protéger de façon écologiquement viables et économiquement soutenables? C’est à ces enjeux et bien d’autres que s’attaquent les travaux de la Chaire Marcelle-Gauvreau en hydraulique et aménagements maritimes et fluviaux.
Face aux risques d’érosion et d’inondation des côtes, trois types de stratégies sont possibles : la protection, le retrait ou l’accommodement. Lorsque l’on décide de protéger le littoral, deux catégories de solutions s’offrent à nous, soit les constructions dites grises parce que souvent en béton (murs côtiers, digues, brise-lames, épis, enrochements) et les autres, dites vertes, ou basées sur la nature (reprofilage par rechargement, végétalisation).
Les solutions vertes de type végétalisées, bien que fortement souhaitées par la société, ont des performances difficiles à prévoir et à assurer sur le long terme, en raison d’un manque de connaissances sur les processus biomécaniques des végétaux et leur couplage avec l’hydrodynamique des vagues. Des règles de conception et des outils normatifs de dimensionnement qui guideraient les pratiques en leur faveur selon les sites font malheureusement défaut à ce jour.
La contribution principale visée de la Chaire est l’élaboration de guides et d’outils pouvant aider à l’établissement de cadres normatifs afin de:
- Concevoir, dimensionner et entretenir des solutions basées sur la nature
- Réduire ou compenser les impacts négatifs s’appliquant sur les ouvrages existants
- Développer des mesures d’atténuation pour contrer les effets cumulatifs de la submersion et de l’érosion des zones côtières.
Inondation côtière
Nous voulons cartographier le risque de submersion marine à partir d’une approche physique, qui permet, entre autres, de tenir compte des transformations des vagues, du large à la côte puis de leur franchissement des ouvrages de protection. Cette particularité permet de prédire avec plus de précision la dynamique de l’inondation en détaillant l’évolution temporelle du couple (hauteur et vitesse d’eau), des paramètres indispensables à l’élaboration d’un plan de gestion de crise pour un plan d’évacuation efficace de la population.
Érosion côtière
Nous étudierons aussi les interactions fluide-sol-ouvrages en contact avec la mer afin d’optimiser la conception des routes côtières et des ports ainsi que la maintenance du parc existant d’ouvrages de protection des côtes.

Solutions vertes ou mixtes
Notre objectif ici est de mieux quantifier les forces naturelles et anthropiques (p. ex. induites par la navigation maritime, les ruptures de barrages) qui s’appliquent aux berges érodables afin d’évaluer l’efficacité et la durabilité des solutions vertes ou mixtes. Nous visons aussi à optimiser leur performance mécanique afin d’étendre leur gamme de fonctionnement et réduire le recours aux solutions grises traditionnelles.
Conclusion
Les changements climatiques s’accélérant, il est essentiel de projeter un éclairage scientifique et de développer de nouvelles méthodes et outils pour aider à adapter ou à renforcer la résilience des territoires concernés. Il n’existe que rarement de solutions uniques et la concertation des différents acteurs est indissociable à une acceptabilité par tous des différents projets de protection. Souvent, une combinaison de différentes solutions offre un compromis convenable aux différents usages des bords de mer.