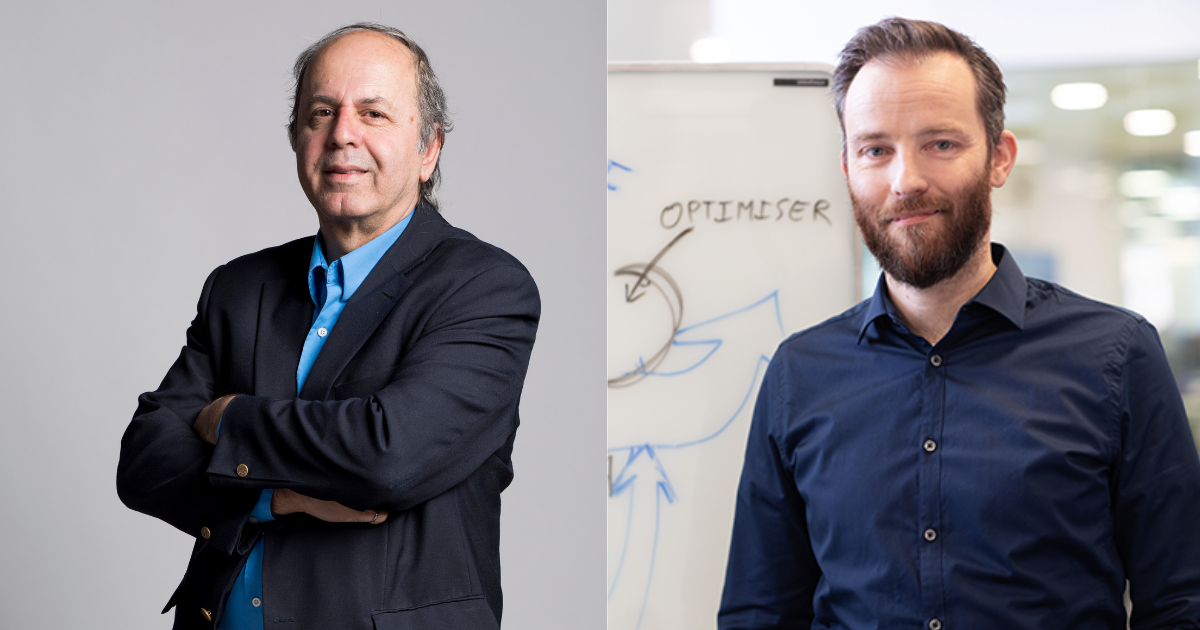Et si l’on pouvait anticiper les effets environnementaux de chaque décision industrielle ou gouvernementale avant même qu’elle ne soit mise en œuvre? C’est le pari d’Andrew Henderson, professeur-chercheur à ÉTS, dont les travaux visent à modéliser, de façon aussi complète que possible, les impacts environnementaux liés aux activités humaines.
Spécialiste des analyses de cycle de vie (ACV), le professeur Henderson adopte une approche holistique qui intègre la santé humaine, les écosystèmes et l’utilisation des ressources naturelles. « Peu importe l’objet ou le projet, une bouteille de boisson, une batterie, un meuble ou même une politique publique, je me pose toujours la même question : quels sont les problèmes environnementaux et que peut-on faire pour les atténuer? », résume-t-il.
De la ferme à la pinte de lait
Prenons l’exemple de la production laitière. Produire un litre de lait implique bien plus que la traite d’une vache. Il faut cultiver des céréales pour nourrir les troupeaux, fabriquer des fertilisants, faire fonctionner des tracteurs, transporter le lait, gérer le fumier, produire des contenants, les distribuer, les réfrigérer… À chaque étape, des polluants sont émis dans l’air, l’eau ou le sol : méthane, oxyde nitreux, nutriments, réfrigérants. Les ACV permettent de déterminer la quantité de chacun de ces composants et leurs impacts.
Une fois les émissions calculées, le professeur Henderson et son équipe utilisent et développent des modèles pour prédire leurs effets : mortalité humaine, impacts sur les écosystèmes causés par l’acidification des sols ou des océans, etc. C’est cette deuxième étape — la modélisation des impacts environnementaux — qui constitue le cœur de son expertise.
Modéliser le parcours des contaminants
La recherche d’Andrew Henderson se distingue notamment par la modélisation du transport des contaminants dans l’environnement. Elle s’intéresse particulièrement aux métaux lourds, aux métaux rares et aux nutriments comme le phosphore, l’azote ou le soufre. En analysant la façon dont ces substances voyagent dans l’eau, l’air ou le sol, le chercheur peut évaluer leurs effets sur les écosystèmes et la santé humaine.
Par exemple, lorsqu’une mine est exploitée, que deviennent les résidus miniers? Et qu’arrive-t-il aux matériaux extraits de la mine en fin de vie utile? Vont-ils contaminer les nappes phréatiques? Rester dans les sédiments? Se retrouver dans la chaîne alimentaire? Les modèles développés par son équipe permettent d’apporter des réponses précises à ces questions.
Un regard à l’échelle planétaire
Les ambitions du chercheur ne s’arrêtent pas au Québec ou au Canada. Avec l’un de ses étudiants, il développe actuellement un modèle mondial d’acidification des mers, causée par les émissions de soufre et d’azote, notamment issues de la combustion. En quadrillant la planète en blocs de 50 km sur 50, le modèle permettra de localiser précisément les impacts des polluants, ville par ville, pays par pays.
Un autre projet vise à modéliser l’évolution du pH mondial, un paramètre clé dans le transport des métaux et d'autres contaminants. En combinant les données existantes et en intégrant des variables souvent négligées dans les modèles actuels, comme le pH ou les substances émergentes comme les PFAS (substances perfluoroalkylées), Andrew Henderson espère développer un cadre de modélisation mondial plus robuste, utile autant pour les chercheurs que les décideurs.
Des applications concrètes, de l’industrie à la politique publique
Le professeur Henderson collabore régulièrement avec divers partenaires industriels et gouvernementaux, comme l’industrie laitière, les fabricants de panneaux solaires et même les manufacturiers d’une bouteille de boisson plus écologique.
Il est également engagé dans des projets d’économie circulaire, comme une étude avec Recyc-Québec et le Réseau de recherche en économie circulaire pour évaluer les réductions possibles de GES dans une économie plus circulaire. Avec Services publics et Approvisionnement Canada, il étudie l’impact environnemental de la réutilisation de mobilier, et avec un groupe lié au secteur du bâtiment, il explore les gains environnementaux possibles en remplaçant des matériaux importés des États-Unis par des matériaux produits localement.
Une science pour éclairer les choix
Selon lui, les ACV sont plus efficaces lorsqu’elles sont réalisées au début d’un projet, avant que les choix technologiques ou les matériaux ne soient plus difficiles à changer. « C’est là qu’on peut vraiment infléchir le cours des choses », dit-il.
Sa passion pour la modélisation vient d’un profond désir d’outiller les décideurs — qu’ils soient dans l’industrie, au gouvernement ou au sein du grand public. « Les gens ne réalisent pas toujours tout ce que peut cacher un produit ou un service, dans sa chaîne d’approvisionnement. Mon rôle, c’est de rendre tout cela visible. »
À l’heure où les gouvernements s’engagent à rendre leurs économies plus durables, les modèles développés par Andrew Henderson et son équipe sont essentiels. Ils permettent d’identifier les impacts réels, de tester des solutions, d’éclairer la réglementation et d’aider les sociétés à évoluer sans dépasser les limites de la planète.