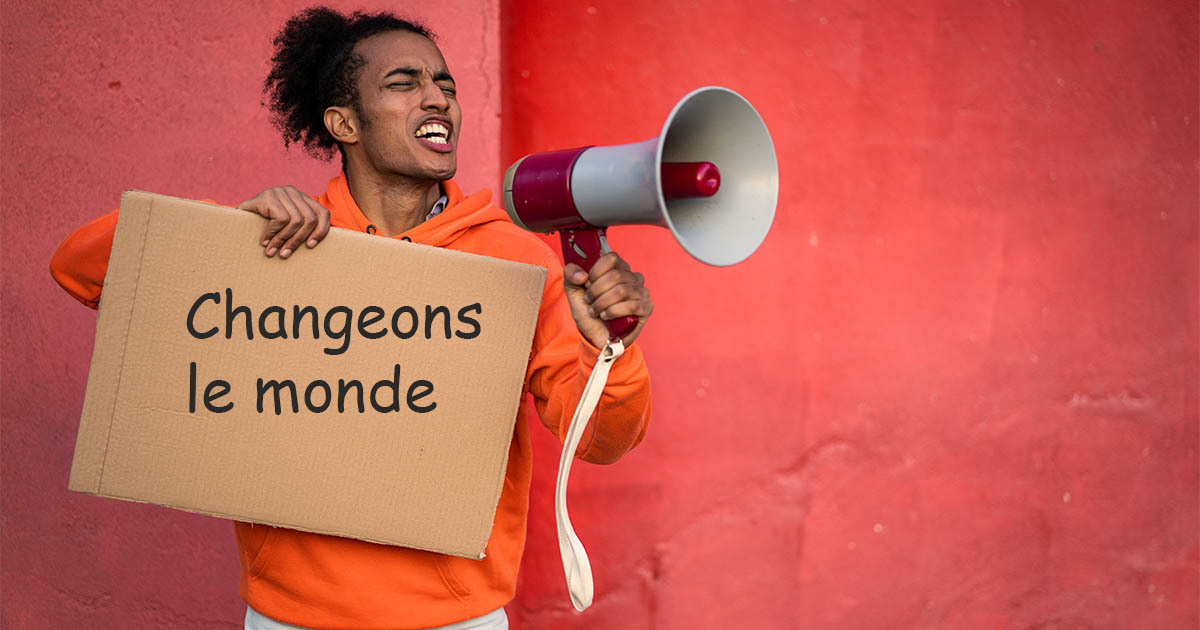À la recherche d’une amélioration de leurs performances, les athlètes de haut niveau poussent leur corps à ses limites. Lorsqu’il s’agit de sport paralympique, l’analyse de chaque geste est encore plus importante pour s’améliorer. Les nageurs et nageuse paralympiques peuvent désormais compter sur un algorithme pour y arriver.
Julien Clément, professeur à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et analyste de performance à l’Institut national du sport du Québec (INS), a développé un algorithme qui permet de traiter des données sur les mouvements des athlètes dans l’eau. Cette approche intègre des principes de l’ingénierie biomécanique dans le but d’optimiser l’efficacité des sportifs et sportives.
De l’orthopédie au sport olympique
L’ingénieur a travaillé pendant 10 ans en orthopédie, en collaboration avec des chirurgiens, pour analyser les troubles musculosquelettiques du genou et de l’épaule. Il apporte aujourd’hui une expertise à la natation paralympique canadienne en combinant son savoir en biomécanique à l’analyse de la performance. Son but est d’optimiser les performances tout en minimisant les risques de blessures, offrant ainsi un soutien indispensable aux athlètes.
S’il s’intéresse à la natation paralympique en ce moment, il n’exclut pas d’utiliser cette expertise au bénéfice d’autres sports, paralympiques ou pas. Cette technologie pourrait donner à de nombreux athlètes la possibilité de mieux comprendre comment leur corps tourne, bouge, s’active et s’améliore.
Un algorithme au service du sport
Le projet phare de Julien Clément est le développement d’un algorithme visant à mesurer les performances dans l’eau. Le dispositif de mesure, de la grosseur d’un timbre épais, s’accroche à l’arrière du maillot de bain de l’athlète. Il renferme un accéléromètre et un gyroscope à trois axes.
Il permet une analyse semi-automatique des données de nage, offrant des informations sur les accélérations linéaires et les vitesses angulaires pendant la nage. « Nous définissons les données à analyser : le type de nage et la distance, par exemple. Une fois la distance de nage terminée par l’athlète, l’algorithme recueille et analyse les données », explique le professeur. L’outil peut ainsi générer plus de 200 paramètres par longueur.

L’ingénieur en biomécanique explique l’importance de pouvoir analyser tous les mouvements du corps et de croiser les données. « On peut analyser les quatre types de nage, selon les cycles de coups de bras. Les données nous permettent notamment de cibler le moment précis dans le cycle où le nageur ou la nageuse perd de la vitesse. Avec les équipes responsables des entraînements on peut travailler sur des exercices spécifiques qui vont renforcer les faiblesses du nageur ou de la nageuse », explique-t-il.
Une des avancées majeures de ce projet est l’évaluation de la distance parcourue par chaque coup de bras. « C’est la première fois qu’on validait la distance parcourue pour chaque cycle de coups de bras à l’aide de ce type d’outil. Maintenant cette étape franchie, j’ai confiance en notre algorithme », affirme-t-il.
Une approche personnalisée

Julien Clément souligne l’importance de cette approche individualisée : « Chaque athlète, qu’il ou elle soit para ou non, possède des forces et des faiblesses uniques. L’utilisation de ces données amène une analyse au cas par cas, main dans la main avec l’entraîneur ou l’entraîneuse. On peut travailler sur des mesures qui confirment le ressenti de l’athlète. On arrive même à mettre des chiffres concrets sur ses ressentis », ajoute fièrement l’ingénieur.
Cette approche sur mesure, développée en collaboration avec les entraîneurs et entraîneuses ainsi que des équipes de recherche de l’INS et de l’université McGill contribue à établir des stratégies personnalisées pour chaque nageur et nageuse, avec un suivi longitudinal pour évaluer l’efficacité des interventions. « Quand on prescrit des stratégies, on peut facilement voir si ça fonctionne avec les données recueillies. C’est beaucoup d’essais pour trouver la bonne stratégie qui donnera les bons résultats », admet le professeur, ajoutant du même souffle que ce travail a des incidences réelles sur les performances des athlètes.
Des obstacles extérieurs
Julien Clément souligne les défis persistants dans le domaine de la natation paralympique. Il évoque notamment le manque de moyens du sport amateur de haut niveau. « Un outil peu coûteux tel que le nôtre pourrait vraiment aider les athlètes à s’améliorer », estime l’ingénieur. Il croit que le manque d’outils empêche le raffinement technique nécessaire pour les athlètes qui aspirent à remporter des médailles.
De plus, le sport paralympique exige une difficile catégorisation des athlètes. « Parfois, l’athlète se situe entre deux catégories, trop fort pour une, pas assez pour l’autre. Certains athlètes sont difficilement catégorisables », indique le professeur. Il croit que l’utilisation d’analyse de données biomécaniques dans l’eau permettrait de rendre plus objective la catégorisation des nageurs et donnerait ainsi une chance plus juste et équitable à chacun d'eux.
Mesurer l’excellence différemment
Par-dessus tout, Julien Clément juge que l’outil qu’il a développé permet de meilleures mesures pour les athlètes, que ce soit pour améliorer leurs performances ou mieux les catégoriser. « Il est possible d’élaborer des outils scientifiquement éprouvés qui peuvent être utilisés sur le terrain. Si le temps reste un indice de performance principal, d’autres indicateurs clés, comme la distance parcourue par coup de bras, les pics d’accélération ou encore la fréquence instantanée des coups, peuvent également mesurer la performance d’un ou une athlète », souligne-t-il.
Il va même jusqu’à s’interroger sur la définition du terme « performance ». « Qu’est-ce que la performance? Ça va dépendre du sport, des mesures disponibles. Est-ce que le temps reste la seule mesure pour déterminer l’excellence de la performance dans un sport de vitesse? » Des questions qui pourraient amener le sport de haut niveau, paralympique ou pas, à s’interroger sur ses pratiques.