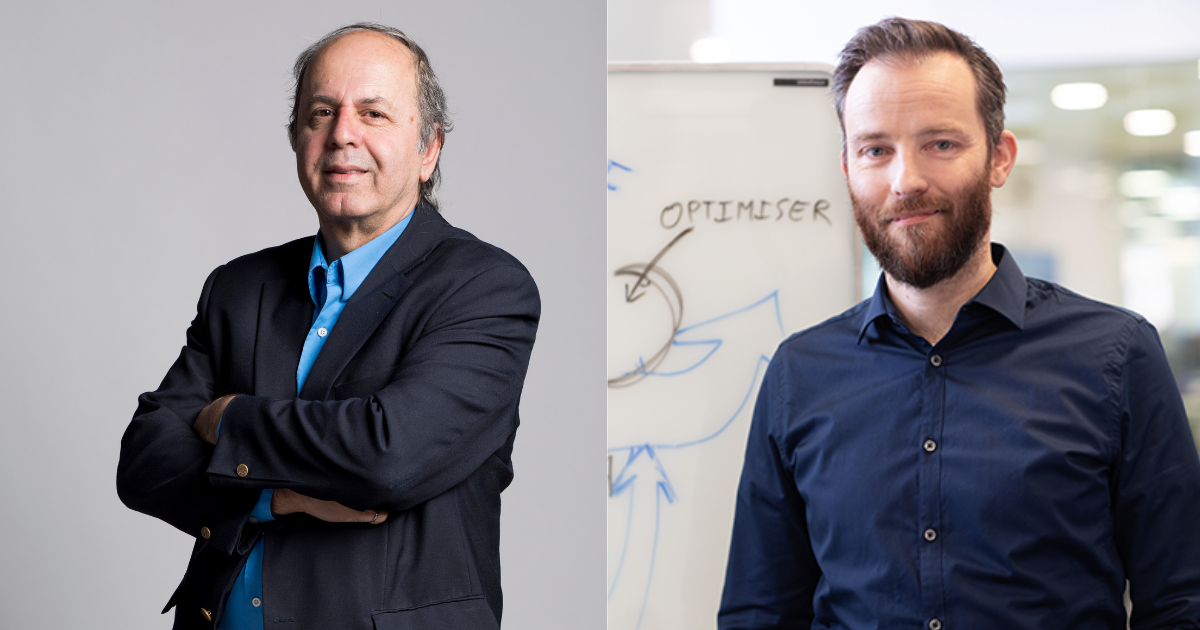Il suffit d’un orage particulièrement intense pour transformer une rivière paisible en torrent dévastateur. Une fonte des neiges trop rapide peut forcer les gestionnaires de barrage hydroélectrique à relâcher de l’eau en urgence pour éviter le débordement. Dans un contexte où les événements météorologiques extrêmes se multiplient, la gestion de l’eau devient une question de sécurité publique autant qu’un enjeu énergétique.
C’est dans cet espace stratégique que s’inscrit la recherche de Richard Arsenault, professeur à l’ÉTS et expert en modélisation hydrologique. Son objectif : développer des outils de prévision et d’aide à la décision pour améliorer la gestion des réservoirs hydroélectriques, mitiger les risques d’inondation et anticiper les effets des changements climatiques.
Gérer l’incertitude en temps réel
L’hydroélectricité repose sur une utilisation optimale des réservoirs. Trop d’eau peut mener à des inondations, pas assez peut compromettre la production. Pour maintenir cet équilibre, les gestionnaires de barrage doivent prendre des décisions quotidiennes en s’appuyant sur des prévisions météorologiques et hydrologiques. Or, ces prévisions sont parfois inexactes ou trop incertaines à moyen terme, ce qui complique la gestion des risques.
Les modèles développés par Richard Arsenault et ses étudiants au Laboratoire HC3 permettent de simuler le comportement des bassins versants selon différents scénarios. Ils tiennent compte de l’humidité des sols, de la couverture neigeuse, de l’historique des précipitations et d’autres paramètres essentiels à la prévision du débit des rivières.
Des algorithmes pour prévoir, décider… et s’adapter
Depuis quelques années, l’équipe utilise des modèles d’intelligence artificielle capables d’apprendre à partir de séries temporelles. Ces réseaux de neurones à mémoire à court et long terme, appelés LSTM, permettent de mieux intégrer les conditions passées pour estimer les volumes d’eau à venir. L’approche offre un changement de paradigme en hydrologie : Les modèles ne se contentent plus de reproduire des comportements observés dans la nature; ils apprennent désormais à les prévoir en s’appuyant sur de grandes quantités de données.
Au-delà de la prévision météorologique et hydraulique, les chercheurs développent également des outils d’aide à la décision, notamment à l’aide de l’apprentissage par renforcement. Ces systèmes proposent des stratégies de gestion de l’eau en fonction des risques attendus, comme la vidange préventive d’un réservoir avant un épisode de pluie. Ces outils servent d’aide à la décision : ils suggèrent des actions possibles à partir des données, mais laissent à un humain la décision finale.
Des collaborations concrètes
La recherche menée par l’équipe de Richard Arsenault se traduit concrètement sur le terrain. Dans un projet réalisé avec Hydro-Météo, une entreprise qui appuie les municipalités et le gouvernement du Québec dans la gestion des inondations, ses travaux ont permis de moderniser un système de prévision hydrologique. Ce type d’outil aide notamment à mieux planifier les interventions en cas d’embâcles de glace ou d’épisodes de fortes pluies.
Dans un contexte de changement climatique, cette recherche est également utile à plus long terme, notamment pour les producteurs d’électricité. Les centrales hydroélectriques étant conçues pour durer de 80 à 100 ans, les entreprises doivent planifier leurs investissements en fonction des quantités d’eau attendues dans les décennies à venir. Les données hydrologiques projetées orientent des décisions comme le remplacement ou la modification des turbines et rassurent les investisseurs et les assureurs.
Les applications dépassent d’ailleurs le secteur de l’énergie. En partenariat avec le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, les chercheurs contribuent à prévoir l’évolution géographique des forêts en fonction de la disponibilité en eau souterraine. Ces analyses servent à orienter les politiques d’aménagement et les autorisations de coupe.
Une science ouverte, une base commune
Consciente de l’importance du partage des données et des outils, l’équipe a également contribué à la création d’une base de données regroupant plus de 14 000 bassins versants à travers l’Amérique du Nord. Cette base, en constante évolution, est utilisée par de nombreux chercheurs pour entraîner de nouveaux modèles d’intelligence artificielle en hydrologie.
Une gestion de l’eau sous pression
Dans un contexte de dérèglement climatique, les épisodes de crue ou de sécheresse seront plus fréquents. Face à cette réalité, l’anticipation devient une condition de survie. Et c’est exactement ce que cherche à rendre possible cette recherche appliquée : mieux prévoir, pour mieux décider, et éviter que la gestion de l’eau ne se transforme en gestion de crise.