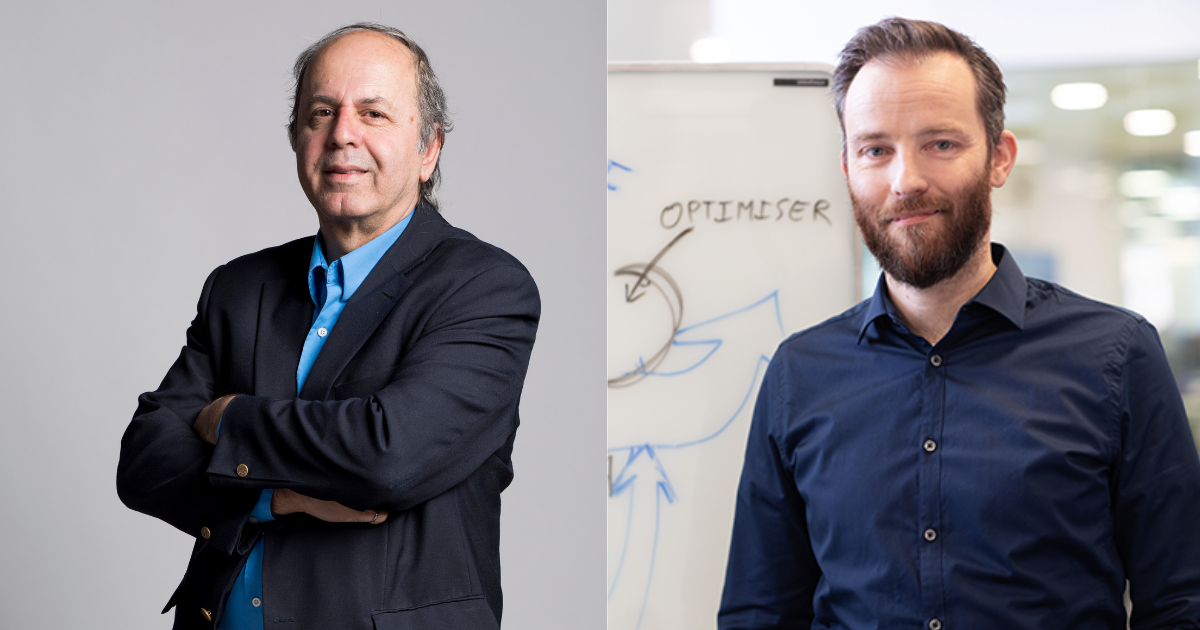Le génie vient prêter main-forte aux psychiatres, psychologues et autres spécialistes des neurosciences lorsque vient le temps de détecter des anomalies pouvant mener à des problèmes de santé mentale et d’autres troubles cérébraux.
Dans le cadre d’une étude menée par le National Institute of Mental Health, aux États-Unis, qui rassemblent plus de 2500 participants et participantes originaires de 14 pays, Sylvain Bouix, professeur-chercheur au Département de génie logiciel et des technologies de l’information de l’École de technologie supérieure (ÉTS), contribue à affiner les méthodes permettant d’aller « voir » dans le cerveau des personnes à risque de développer des troubles psychotiques.
Sonder le cerveau
Le travail de Sylvain Bouix est double : « D’un côté, je travaille sur de nouvelles méthodes pour analyser des données d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau, y compris des façons d’identifier des structures neuroanatomiques. D’un autre côté, je développe des outils pour améliorer la gestion et le partage de données multimodales afin de faciliter leurs analyses par des scientifiques spécialisés en neurosciences, en psychiatrie ou en psychologie ».
Comme l’explique le chercheur, ces mêmes spécialistes seront ensuite en mesure d’étudier plusieurs questions en lien avec la santé mentale des individus. Des questions telles que « si j’ai une personne qui présente des symptômes légers, ou qui a l’air d’avoir besoin de l’aide d’un ou d’une psychologue ou psychiatre, si l’on recueille de grandes quantités de données, est-ce que l’on peut prédire si elle va devenir vraiment malade? Est-ce qu’elle va s’en remettre? Est-ce qu’elle va demeurer stable? » évoque le chercheur.
Ce dernier se demande aussi s’il est possible de déterminer – encore une fois grâce aux données recueillies et à leur analyse – si un groupe de gens est plus à risque de développer des problèmes cérébraux, « est-ce que c’est alors une bonne idée de faire essayer un médicament en particulier à ces personnes, plutôt que d’utiliser le même médicament pour tous? ».
Sylvain Bouix est toutefois catégorique : s’appuyer seulement sur des données d’IRM ne permettra pas d’établir un diagnostic complet afin d’établir si une personne est à risque de développer de la schizophrénie, par exemple. « On parle vraiment de données multimodales », mentionne-t-il.

Pour ce faire, de nombreuses autres données doivent être colligées. « Dans le cadre de l’étude à laquelle je participe présentement, ils et elles ont vraiment tout ce que l’on peut imaginer comme données. Les sujets sont ainsi testés de manière clinique – avec des entretiens, pour voir comment ils vont, s’ils entendent des voix, s’ils ont des symptômes de paranoïa, etc. Les sujets subissent une batterie de tests cognitifs ainsi que des prélèvements sanguins et de salive, ils ont droit à un électroencéphalogramme, des IRM », énumère le chercheur.
Les participants et participantes passent aussi par « une analyse du langage, portent un actigraphe et utilisent une application sur leur téléphone ».
Ce même téléphone peut notamment servir, via le GPS intégré, à déterminer si une personne n’est pas sortie de chez elle depuis quelques jours, ce qui pourrait signifier que son état se dégrade.
À terme, l’objectif consiste bien sûr à établir une série de protocoles pour mieux cerner les signes avant-coureurs d’un problème cérébral, mais aussi aider les sociétés pharmaceutiques à mettre au point de nouveaux médicaments, plus efficaces que ceux qui sont offerts présentement.

« Ce que l’on a en ce moment pour traiter la schizophrénie ou la psychose, ce sont des antipsychotiques, ce qui est vraiment l’équivalent de déposer une serviette mouillée sur le cerveau, explique Sylvain Bouix. Ce n’est pas du tout spécifique. Pire encore, en général, les gens qui prennent ces médicaments n’aiment pas ça du tout. »
« C’est sûr que cela réduit largement les symptômes de la schizophrénie, mais cela entraîne également beaucoup d’effets secondaires », ajoute-t-il.
Attention au manque de données
Autre obstacle que l’étude à laquelle participe Sylvain Bouix tente de surmonter : le manque de données variées.
Comme le mentionne le chercheur, les algorithmes de détection des anomalies des images d’IRM, par exemple, s’appuient sur des données souvent recueillies auprès de petites populations similaires, soit des groupes partageant les mêmes caractéristiques physiques, socioéconomiques et géographiques.
« Notre problème, explique Sylvain Bouix, c’est que nous n’avons pas de sources de vérité pour nous indiquer si les résultats obtenus, en utilisant un algorithme, se rapprochent d’une base fiable » qui permettrait de valider ou non ces résultats.
D’où cette grande variété dans les participants et participantes à l’étude.
Une fois cette étude complétée, et les informations recueillies analysées, la prochaine étape consistera à réaliser des essais cliniques. Avec, à la clé, non seulement de possibles nouvelles méthodes pour détecter et prévenir les troubles cérébraux, mais aussi pour concevoir de nouveaux traitements et médicaments destinés à ces populations à risque.