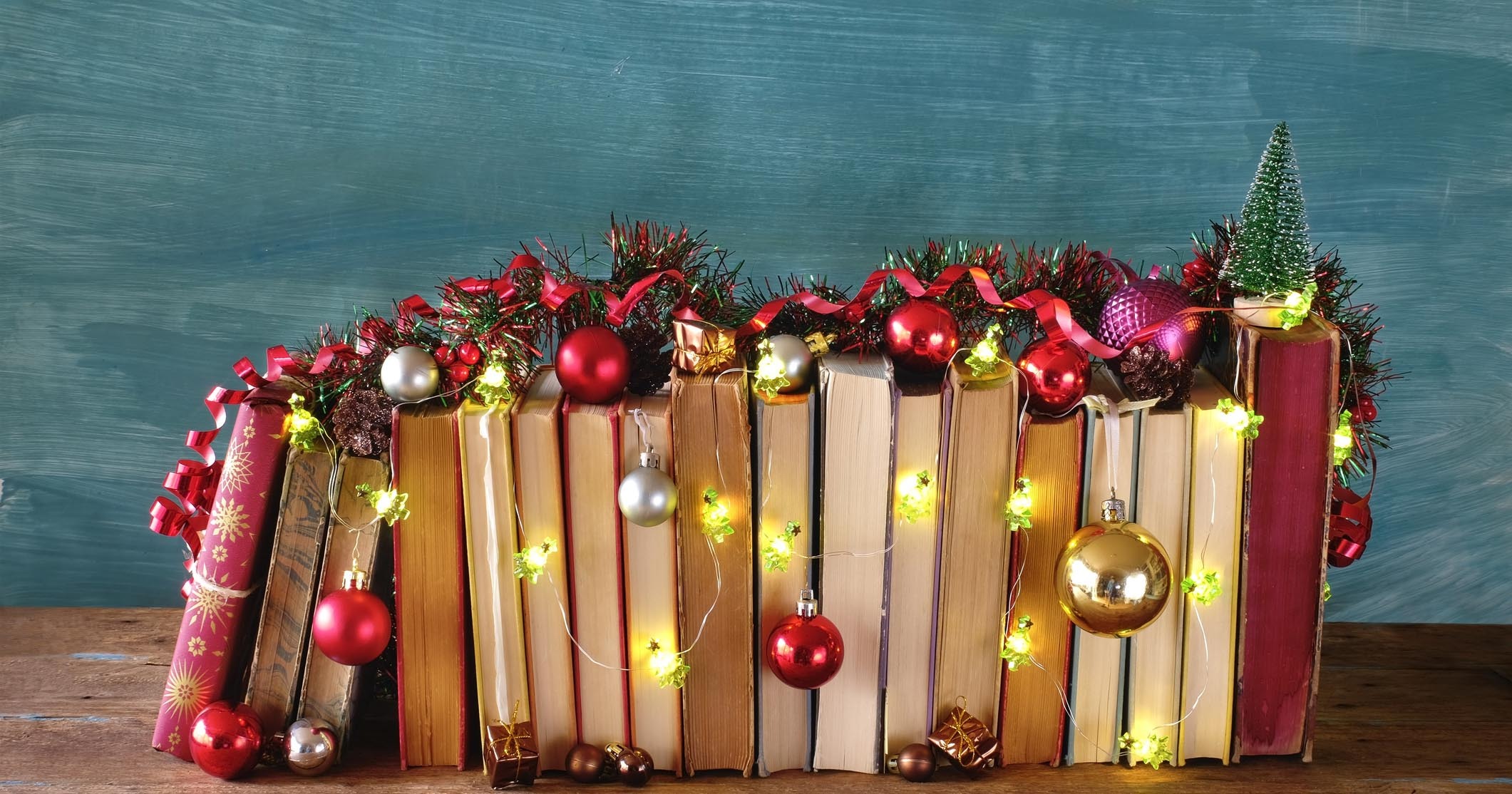De nouveaux contaminants apparaissent régulièrement sur le radar des scientifiques. Ils ne sont pas forcément « nouveaux » dans l’environnement, mais nouvellement détectés ou encore récemment reconnus comme problématiques. Ces contaminants émergents n’étaient tout simplement pas pris en compte au moment où nos usines de traitement d’eau ont été conçues.
Mathieu Lapointe, professeur à l’ÉTS, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la protection des ressources en eau et de l’environnement et Directeur du laboratoire de génie des eaux à l’ÉTS (LGEPE), s’attaque à ce défi. Ses travaux visent à adapter nos infrastructures d’eau potable et d’eaux usées afin qu’elles puissent mieux intercepter ces polluants et faire face aux nouvelles réalités environnementales.
Intercepter les contaminants émergents
Les usines d’eau potable et d’épuration au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde reposent sur des procédés développés il y a plusieurs décennies. Or, on y trouve aujourd’hui des substances qui échappent aux systèmes actuels de traitement, comme les nanoplastiques, les composés perfluorés (PFAS), les composés pharmaceutiques ou certains pesticides.
Les PFAS sont particulièrement préoccupants. Présents dans des produits du quotidien – colles, enduits, peintures, textiles, tapis, emballages, produits pharmaceutiques – ils sont extrêmement stables et donc quasi indestructibles dans la nature. Même si leur utilisation est désormais restreinte, ils persistent dans les sols, les rivières et les nappes phréatiques, notamment à travers les lixiviats provenant de sites d’enfouissement contenant d’anciens produits manufacturés.
Éliminer ces contaminants par des procédés avancés coûterait des milliards de dollars au Québec. C’est pourquoi l’équipe de Mathieu Lapointe mise sur une approche plus réaliste : améliorer les procédés existants plutôt que de les remplacer.
Son équipe a breveté à l’ÉTS un nouveau média filtrant qui améliore la filtration granulaire, un procédé fondé sur le passage de l’eau à travers un milieu poreux (généralement du sable). En modifiant la chimie de surface du sable par une greffe chimique, elle a créé un matériau capable de capter jusqu’à 30 % de PFAS de plus que le sable conventionnel.
Cette approche permet d’utiliser les infrastructures déjà en place : il suffit de remplacer le média filtrant, pas tout le système. C’est une solution à la fois efficace, économique et rapide à déployer.
Pour aller plus loin, le chercheur collabore avec des chimistes afin d’explorer de nouvelles greffes et de concevoir des matériaux capables de cibler d’autres familles de contaminants.
Des filtres pour les eaux agricoles

Le deuxième volet de la recherche concerne les eaux de drainage agricoles, une source de pollution souvent sous-estimée. Ces eaux, qui ruissellent des champs vers les cours d’eau, contiennent de fortes concentrations de phosphore, d’azote et de pesticides, mais ne passent par aucun traitement à l’heure actuelle.
L’équipe de Mathieu Lapointe développe donc des filtres adaptés à cette réalité. Ici, la greffe chimique du sable est ajustée pour capter ces nutriments et polluants : on y intègre notamment du fer, qui a une grande affinité avec le phosphore.
Ces filtres prendraient la forme de bandes riveraines fonctionnalisées, constituées de sable greffé, installées en bordure des champs. Ce sont des procédés passifs, simples et peu coûteux, qui ne nécessitent pas d’énergie et permettent de réduire significativement la pollution diffuse agricole. Comme le souligne Mathieu Lapointe : « On n’enlèvera pas tout, mais pour l’instant, on n’enlève rien. »
Agrandir les usines… de l’intérieur
Au Québec et au Canada, plusieurs usines d’épuration ont atteint leur capacité maximale. Résultat : les débordements d’eaux usées sont de plus en plus fréquents, surtout lors de fortes pluies. Montréal, avec son réseau d’égouts unitaire, en est un exemple typique.
Plutôt que de construire de nouvelles installations, option souvent impossible faute d’espace ou de budget, le chercheur propose d’augmenter la capacité de traitement des usines existantes grâce à une autre innovation brevetée à l’ÉTS : les superfloculants. Ces travaux sont menés dans le cadre de l’Institut AdapT.
Ces additifs, intégrés aux procédés de floculation-coagulation, permettent de former des flocs (petites particules agrégées) plus gros et plus denses, qui décantent plus rapidement. Cela réduit le temps de rétention nécessaire dans les bassins et permet de traiter un volume d’eau plus important sans agrandir les infrastructures.
Innover pour s’adapter
Les contaminants ne disparaissent pas d’eux-mêmes et nos infrastructures, conçues il y a parfois des décennies, atteignent leurs limites. La recherche de Mathieu Lapointe montre qu’il est possible d’adapter nos systèmes existants, en misant sur l’innovation, la chimie des matériaux et l’intelligence des procédés.
La ville de Montréal, d’ailleurs, fait preuve de proactivité en testant certaines de ces solutions pour réduire la présence de contaminants persistants.
En combinant science appliquée, créativité et pragmatisme, la Chaire de recherche du Canada sur la protection des ressources en eau et de l’environnement contribue à aider nos infrastructures à évoluer au même rythme que les défis environnementaux.