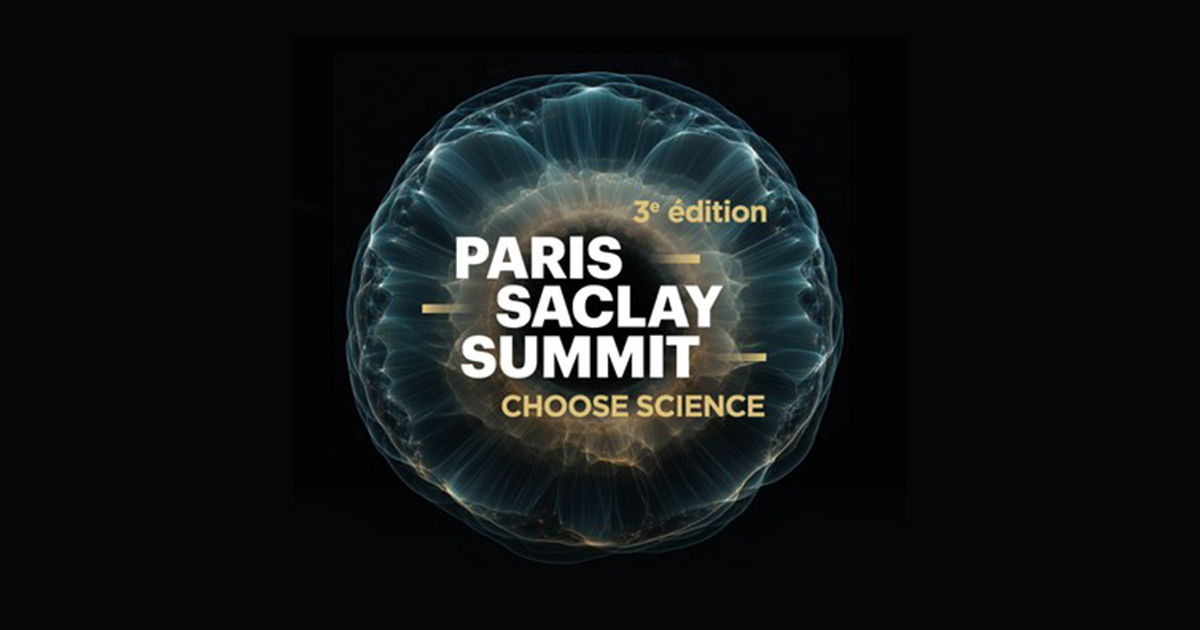Les émissions de l’industrie aéronautique
Le trafic aérien connaît une croissance constante à l’échelle mondiale, ce qui accentue l’impact environnemental du secteur. Bien que les avions de nouvelle génération soient plus efficaces sur le plan énergétique, ces améliorations ne suffisent pas à compenser l’augmentation globale des émissions. En brûlant de grandes quantités de kérosène, les moteurs d’avion rejettent dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone (CO₂), contribuant ainsi au réchauffement climatique.
À court terme, les carburants durables pour l’aviation (SAF, pour sustainable aviation fuel) représentent une solution prometteuse pour réduire les émissions de CO₂. Contrairement aux carburants fossiles, qui introduisent du carbone « neuf » dans l’atmosphère, les SAF recyclent le carbone déjà présent dans le cycle naturel. Produits à partir de matières premières telles que les huiles végétales usagées, les graisses animales ou encore les résidus de biomasse, ces carburants émettent un CO₂ issu du carbone absorbé par les plantes via la photosynthèse.
Cependant, l’effet des SAF sur les émissions dites « non-CO₂ » — comme la vapeur d’eau, les particules de suie, les hydrocarbures imbrûlés, les aérosols ou encore les sulfures — reste encore mal compris. Or, ces émissions jouent un rôle déterminant dans la formation des traînées de condensation, ces longues stries blanches que l’on voit dans le ciel derrière les avions. Ces traînées, en raison de leur effet de forçage radiatif, pourraient contribuer davantage au réchauffement climatique que le CO₂ lui-même. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce projet de recherche, dont l’objectif est de mieux comprendre les mécanismes de formation des traînées de condensation et leur évolution dans l’espace et le temps.
Modélisation des traînées de condensation : une approche multidisciplinaire
Pour qu’une traînée de condensation se forme, certaines conditions atmosphériques sont nécessaires, notamment un environnement froid et humide. Lors de la combustion, les moteurs d’avion libèrent non seulement de grandes quantités de vapeur d’eau, mais aussi de fines particules de suie et de composés soufrés qui agissent comme noyaux de condensation, favorisant la formation de cristaux de glace. Le comportement des traînées — en particulier leur persistance et leur impact climatique — dépend du nombre et de la taille de ces cristaux, mais les processus physico-chimiques en jeu sont encore mal connus. L’un des principaux défis réside dans la nécessité de modéliser des phénomènes à des échelles très différentes : des particules de taille micrométrique interagissent avec un écoulement qui s’étend sur plusieurs kilomètres, dans le sillage de l’avion.
À l’heure actuelle, les modèles scientifiques décrivant la formation des traînées de condensation reposent sur de nombreuses hypothèses. Pour améliorer leur précision, des données expérimentales sont indispensables. C’est dans ce but qu’une série de mesures sera réalisée sur un Airbus A220, à la fois au sol et en vol, lorsque alimenté en carburant durable (SAF). Quatre types de carburants SAF seront testés au sol sur le site de l’aéroport de Mirabel. En vol, un avion chasseur, équipé comme un laboratoire volant, recueillera des échantillons à des distances allant de 150 mètres à 30 kilomètres derrière l’Airbus. Afin de mieux comparer l’influence des différents carburants sur la formation des traînées, deux Airbus A220, chacun alimenté par un carburant distinct, voleront côte à côte. Cette configuration permettra de minimiser l’influence des variations climatiques sur les résultats.
L’équipe de recherche de l’ÉTS s’appuiera sur des simulations de mécanique des fluides numériques (CFD) couplées à des modèles de microphysique atmosphérique pour simuler la formation des cristaux de glace. À partir de ces simulations, un modèle d’ordre réduit, basé sur l’intelligence artificielle, sera développé en collaboration avec Polytechnique Montréal. Ce modèle pourra être utilisé par les industriels dès la phase de conception, leur permettant d’optimiser leurs technologies en vue d’une aviation plus durable et respectueuse de l’environnement.
Une étude internationale
Ce projet de recherche réunit de nombreux partenaires en Amérique du nord et en Europe : Pratt & Whitney, Missouri University of Science & Technology, Aerodyne, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), Washington State University, la NASA, le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Airbus SAS, Polytechnique Montréal et FSM Management Group.