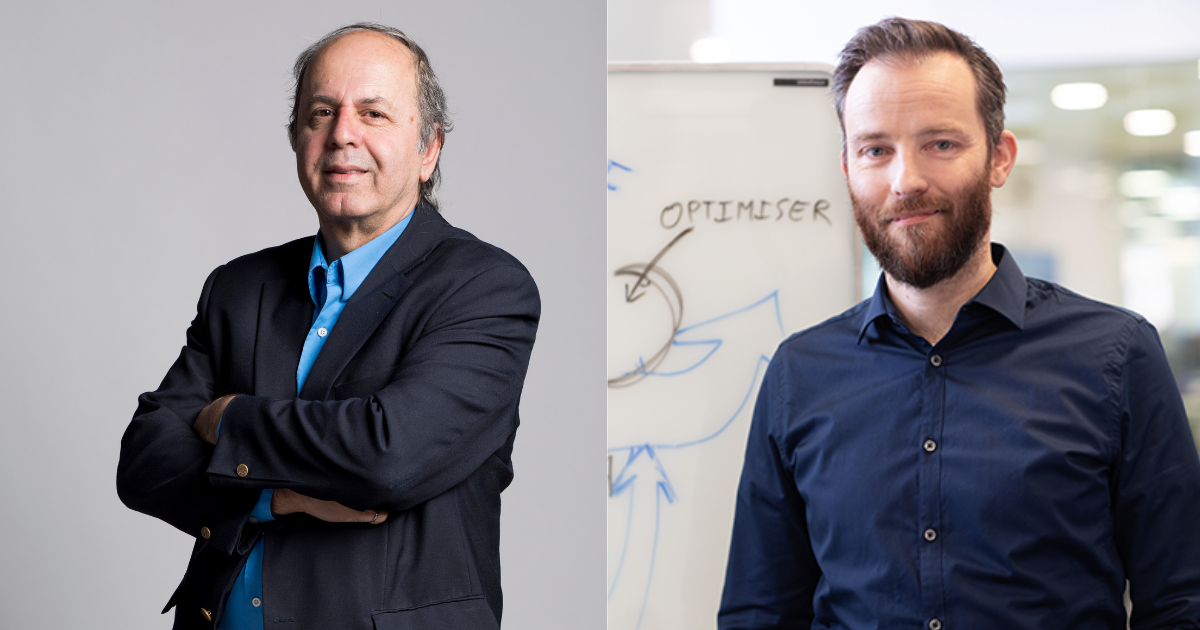Cet été, pour la toute première fois, des étudiants et étudiantes à la maîtrise en génie de l’environnement de l’ÉTS ont pu suivre un nouveau cours intensif donné au campus de Sainte-Marthe. Intitulé Méthodes de caractérisation en hydrologie et hydrogéologie, le cours visait à compléter leur formation théorique par une expérience terrain.
Une immersion complète dans la réalité du terrain
Conçu et encadré par Janie Masse-Dufresne et Adrien Dimech, tous deux membres du corps professoral de l’ÉTS, le cours proposait une approche expérientielle étalée sur trois semaines, à raison de deux jours par semaine. L’objectif : permettre de manipuler des instruments, de récolter des données en conditions réelles et de confronter les résultats à la complexité du monde physique.
Réparti en petites équipes, le groupe a exploré une variété de techniques de mesure adaptées à différents contextes. Le bassin versant de Sainte-Marthe, d’une superficie de 10 km², offrait des conditions variées — des zones de faible débit en amont aux courants plus importants en aval — qui exigeaient de choisir avec soin les méthodes les plus appropriées. Les participants et participantes ont expérimenté des approches classiques (jaugeage, échantillonnage des eaux souterraines, mesures physico-chimiques et techniques d’hydro-géophysique) ainsi que des méthodes innovantes, comme l’analyse des isotopes stables pour retracer l’origine de l’eau.
Travailler avec des données imparfaites

Contrairement aux exercices en classe où les données sont souvent idéalisées, les étudiants et étudiantes ont ici dû composer avec des résultats fluctuants, parfois divergents. Ils ont appris que la plupart des mesures sont indirectes et que chaque méthode comporte ses limites et ses biais.
Cette confrontation à la réalité du terrain les a poussés à se questionner sur la qualité et l’interprétation des données, à reconnaître les incertitudes et à mieux comprendre le cycle de l’eau dans le bassin versant à l’étude. Le cours ne visait pas à obtenir des résultats parfaits, mais à développer un jugement critique, une compréhension fine des méthodes et une rigueur scientifique.
Méthodologie, rigueur et collaboration
Le cours accordait également une grande place au travail en équipe et au partage des connaissances. Certaines des manipulations était d’abord apprise par un seul membre de l’équipe, qui avait la responsabilité de l’enseigner aux autres. Cette dynamique favorisait le mentorat entre pairs, tout en renforçant l’autonomie.
Les étudiants et étudiantes ont aussi appris à bien documenter leurs échantillons et données : identification précise, géolocalisation, conditions de prélèvement, filtration ou non… autant de métadonnées essentielles pour assurer la traçabilité et la réutilisabilité des résultats, que ce soit par les autres équipes, dans un mémoire ou dans une future campagne scientifique.
Préparer la relève scientifique
En fin de parcours, les équipes ont développé un plan d’investigation : quelles données manquent encore? Quelles méthodes seraient les plus appropriées pour les obtenir? Cet exercice de synthèse les a préparés à planifier leurs propres campagnes de terrain dans leurs projets de maîtrise ou de doctorat.
Les retombées de cette formation sont concrètes. Les participants et participantes en sortent mieux outillés pour produire des mesures fiables, évaluer la qualité des données existantes, ou bâtir des méthodologies solides pour leurs travaux de recherche. Même ceux qui ne retourneront pas eux-mêmes sur le terrain auront acquis les réflexes nécessaires pour apprécier la valeur — et les limites — des données disponibles.

Une formule appelée à se répéter
Devant l’enthousiasme suscité par cette première édition, un second cours terrain est est offert cet automne et les inscriptions sont encore ouvertes. Ce cours sera cette fois axé sur les méthodes géophysiques appliquées à l’hydrogéologie et à la géotechnique. À plus long terme, ce type d’approche immersive sur le terrain pourrait nourrir le futur baccalauréat en génie de l’environnement de l’ÉTS, qui misera exclusivement sur l’apprentissage par problèmes et délaissera les cours magistraux.
L’expérience a porté fruit : les étudiantes et étudiants quittent le terrain plus confiants, mieux armés pour contribuer activement aux grands défis environnementaux.