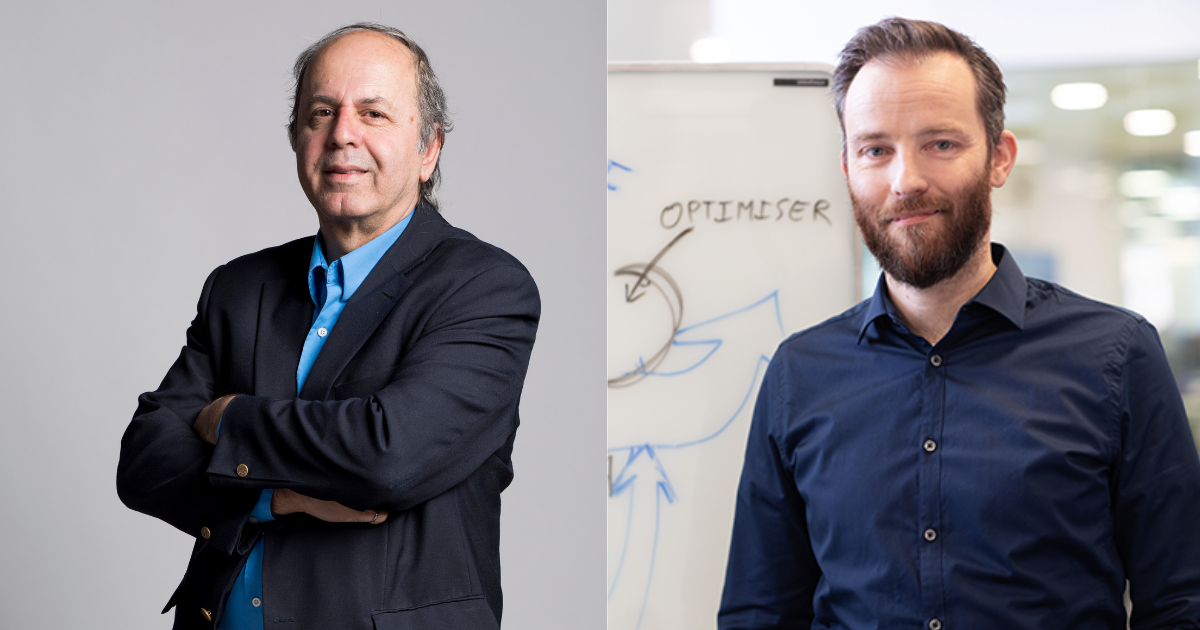Sur un fond flouté et foncé, un texte s'affiche en blanc au-dessus du logo circulaire du PIAC, arts et culture: « En novembre 2023, l'École de technologie supérieure lançait officiellement la première édition de son programme de résidence artistique alliant technologie, science et arts. »
Le texte disparaît et un autre s'affiche: « Cette initiative d'intégration des arts et de la culture portée par le Bureau du développement durable a comme objectif de favoriser les maillages et de susciter des collaborations inédites entre la communauté artistique et la communauté de recherche. »
Un homme hors champ dit: « Et voilà. »
L'écran devient noir puis différents tubes lumineux manipulés par des personnes dans un laboratoire apparaissent. Une femme travaille sur un ordinateur portable. Un texte s'affiche en bas à gauche: « Début des expérimentations, 18 juillet 2024 ».
Dans le laboratoire, un homme consulte un ordinateur et manipule des tubes lumineux. Puis, il apparaît debout dans le laboratoire, identifié: « Ghislain Brodeur, artiste visuel ». Il dit: « En fait, ce qu'on a envie d'explorer et tester, Élisabeth et moi, on va entre autres utiliser la fibre optique, on va utiliser la fibre optique en verre, on va continuer aussi notre exploration et l'utilisation des diodes lasers, chose que je n'avais jamais utilisée auparavant. »
Des images du laboratoire défilent. Puis une femme apparaît debout dans le laboratoire. Elle est identifiée « Élisabeth Picard, artiste visuelle ». Elle dit: « Bien, le fait de pouvoir travailler avec Bora Ung, ça va vraiment nous aider à avancer notre recherche avec la fibre optique. On avait seulement effleuré un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. On travaillait aussi avec juste des lumières LED plus ordinaires, et là, on se fait ouvrir tout un univers ici. On voit que les chercheurs travaillent avec des lasers, ils travaillent avec des guides d'ondes. Pour nous, c'est des choses qu'on ne connaissait pas, alors là, on est en train d'utiliser un peu les mêmes techniques, mais en le faisant sur mesure pour nous. »
Des images des trois chercheurs travaillant dans le laboratoire défilent. Puis un homme apparaît, debout dans une classe. Il est identifié: « Bora Ung, professeur, département de génie électrique ». Il dit: « Les équipements particuliers au laboratoire consistent en tout ce qui a trait au design, la fabrication et la caractérisation de fibres optiques et de guides d'ondes. Donc dans les deux cas, c'est pour transmettre la lumière. Typiquement, dans notre labo, c'est pour des applications en télécommunications et pour faire des capteurs. »
Des images de différents tubes, de fibres lumineuses et de travail dans le laboratoire défilent. Puis, Élisabeth apparaît à nouveau. Elle dit: « Ce dont on se rend compte, c'est qu'ici, beaucoup de l'équipement utilisé est déjà industriellement fabriqué. Nous, c'est vraiment dans le spectre visuel, alors il faut qu'on s'adapte. Même qu'on est obligés de prendre des lasers qui existent, de les démonter pour les mettre sur les lasers qu'on veut parce que sinon, on n'a pas de lentilles, puis ça donne pas les effets qu'on veut. »
Ghislain revient à l'écran. Il dit: « On a étudié certaines options à savoir comment je peux m'y prendre pour non seulement allumer les lasers pour les utiliser à 100 % de leurs capacités et ne pas les brûler. Ensuite de ça, moi, je dois être en mesure de pouvoir les contrôler en intensité. »
Bora apparaît, debout dans la classe. Il dit: « Dans nos recherches, on essaie le plus possible de maximiser la quantité de lumière qu'on injecte dans nos guides d'ondes et dans nos fibres optiques. Et on essaie de minimiser les pertes optiques durant la transmission. Dans ce qu'on explore avec Ghislain et Élisabeth, c'est l'importance du rendu visuel. Donc les pertes optiques, c'est pas vraiment important. Et en fait, on s'est aperçus qu'on peut même les utiliser à bon escient ces pertes-là pour justement améliorer l'aspect visuel de leurs guides d'ondes. »
Des images de travail dans le laboratoire défilent. Puis, Ghislain apparaît de nouveau. Il dit: « On travaille avec des ingénieurs, des chercheurs au niveau universitaire. Ça nous permet de sortir de notre zone de confort et d'apprendre à travailler avec des instruments, des matériaux qui ne sont pas nécessairement accessibles ailleurs. »
Des images des trois chercheurs travaillant dans le laboratoire défilent alors qu'Élisabeth parle. Elle dit: « Au fur et à mesure qu'on est venus ici puis qu'on a des discussions, on a tout le temps des nouvelles pistes qu'on a envie d'essayer fait qu'on est encore beaucoup dans l'exploration en ce moment. J'apprends beaucoup de choses... sur les phénomènes optiques. Moi, je suis une sculpteure, je vis vraiment dans ce qui est tangible. Et quand je comprends pas ce qui se passe, bien, c'est vraiment apprécié d'avoir tout l'aspect scientifique apporté par Bora. »
Élisabeth manipule des fibres lumineuses. Puis, l'écran devient lentement noir.
L'écran s'éclaircit, révélant une grande affiche du PIAC. Dans un pavillon, plusieurs personnes sont assises sur des chaises face à une petite scène. Un texte s'affiche en bas à gauche: « Événement de mi-résidence, 26 septembre 2024 ».
Un homme se tient debout sur la scène. Il dit: « Bonsoir tout le monde. Bienvenue et merci d'être présents en si grand nombre. J'inviterais Bora Ung, Élisabeth Picard et Ghislain Brodeur à nous rejoindre. »
Sous les applaudissements du public, Bora, Élisabeth et Ghislain rejoignent l'homme sur scène et s'assoient tous dans des fauteuils. L'homme est identifié « Cédrick Pautel, secrétaire général et directeur exécutif de l'engagement organisationnel ». Il dit: « Alors, bien, écoutez, merci d'être là. Élisabeth et Ghislain, ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Comment ça a commencé tout ça, entre vous, votre pratique artistique? »
Tenant un micro, Élisabeth dit: « Bien, en fait, on s'est rencontrés à la foire de Saint-Lambert en 2013. Puis, on a commencé à se côtoyer amicalement. Puis finalement, on s'est mis à travailler sur des projets pour moi. »
Cédrick demande: « Puis ici, si on parle un petit peu du projet sur lequel vous travaillez avec Bora, ça ressemble à quoi si vous aviez à nous le décrire? »
Tenant un micro, Élisabeth dit: « Il me passe le micro en riant parce qu'on a trop de projets. Mais notre projet initial, celui avec lequel j'ai appliqué en fait, c'est qu'on a commencé à toucher à la fibre optique un peu grâce à la bourse, et j'ai découvert que je pouvais teindre la fibre optique de plastique et j'avais envie de créer une espèce d'effet de figure de Lichtenberg, tu sais, un peu les éclairs, les ramifications que ça fait quand il y a un coup d'éclair qui frappe un objet. C'est super prometteur, mais en même temps, c'est quand même très complexe à réaliser. »
Tenant un micro, Ghislain dit: « J'ai eu une idée, en fait. J'ai coulé une pièce en béton dans laquelle j'ai intégré 140 bouts de guides d'ondes. Où est-ce que je m'en vais avec ça exactement, j'en ai aucune idée. Afficher des messages, des dates impossibles, les images... Je sais pas encore. »
Cédrick se tient seul debout sur la scène, face au public. Il dit: « Bien, merci. Il y a des tables de démonstration, les artistes vont être là avec nous, les professeurs aussi, donc vous allez pouvoir leur poser des questions. Je vous remercie d'avoir été présents. »
Le public applaudit. Puis les gens discutent autour des tables de démonstration et de petites tables rondes. Les chercheurs donnent des explications à des personnes. Puis, l'écran devient progressivement noir.
L'écran s'éclaircit, révélant le pavillon D sous la neige. Un texte apparaît en bas à gauche: « Sortie de résidence artistique, 29 janvier 2025 ».
Dans le pavillon, Cédrick se tient sur un palier, devant un escalier. Il dit: « Je pense qu'on aurait pas pu espérer mieux comme projet pilote, parce que c'était ça au départ; on essayait quelque chose de nouveau. Alors je suis emballé par les perspectives que ça ouvre, tant de collaborations entre les professeurs et les artistes, qui vont se poursuivre, j'en suis persuadé, au-delà de la résidence. »
Sur une scène, Élisabeth, Ghislain et Bora font une présentation devant un écran géant. Des images de la présentation et de Cédrick se succèdent. Il dit: « Puis je suis emballé aussi par l'expérience que les étudiants ont pu aller chercher à travers ça. C'est comme un bonus dans leur parcours académique. Puis je suis emballé pour l'ÉTS de voir le niveau de maturité qu'on a atteint comme organisation dans nos relations avec la communauté dans un domaine en particulier qui est celui des arts. »
Quelqu'un insère un carton dans un appareil et le mot « PAIN » apparaît en petits points lumineux. Puis Bora se tient sur un palier. Il dit: « La résidence m'a apporté quand même beaucoup de visibilité sur l'expertise qu'on a au laboratoire, autant au niveau du Québec que national. »
Des images de divers faisceaux lumineux et de Bora se succèdent. Il dit: « Pour mes étudiants, pour leurs travaux aussi, de voir l'impact de leurs recherches, ça peut prendre plusieurs années. Et là, avec ce type de projet, ils pouvaient voir pratiquement immédiatement le concret. Et ils sont très heureux, d'après les commentaires que j'ai, de voir un peu les résultats aujourd'hui à la fin de la résidence. »
Un homme se tient sur un palier, devant un escalier. Il est identifié: « Ghyslain Gagnon, doyen de la recherche ». Il dit: « On a l'expertise, on a les infrastructures, puis même si tous nos professeurs, nos chercheurs, nos équipements sont très utilisés, il reste toujours de la place, il reste toujours de la disponibilité pour faire autre chose. Puis on veut former des ingénieurs, des chercheurs, mais on veut aussi former des citoyens, des gens qui ont une vision un petit peu plus large du monde que leur sujet de recherche. »
Dans une aire ouverte, des gens discutent autour de tables de démonstration avec diverses installations lumineuses et en petits groupes. Puis l'écran devient progressivement noir.
Sur un fond foncé et flouté, un texte apparaît en blanc au-dessus du logo circulaire du PIAC: « Au terme de la résidence, Élisabeth Picard et Ghislain Brodeur ont présenté trois oeuvres sculpturales et plusieurs expérimentations issues de leur collaboration avec Bora Ung et son équipe. »
Le texte disparaît et un autre s'affiche: « Les artistes estiment que les expérimentations menées pendant cette période ont un impact durable sur leur pratique, et que les résultats de leurs recherches se manifesteront progressivement dans leurs futurs projets artistiques. » Puis, l'écran devient noir.
Sur un fond blanc, le sigle de l'ÉTS apparaît dans un carré rouge avec les mots « Le génie pour l'industrie ». À droite s'affiche en noir: « École de technologie supérieure, Université du Québec ».