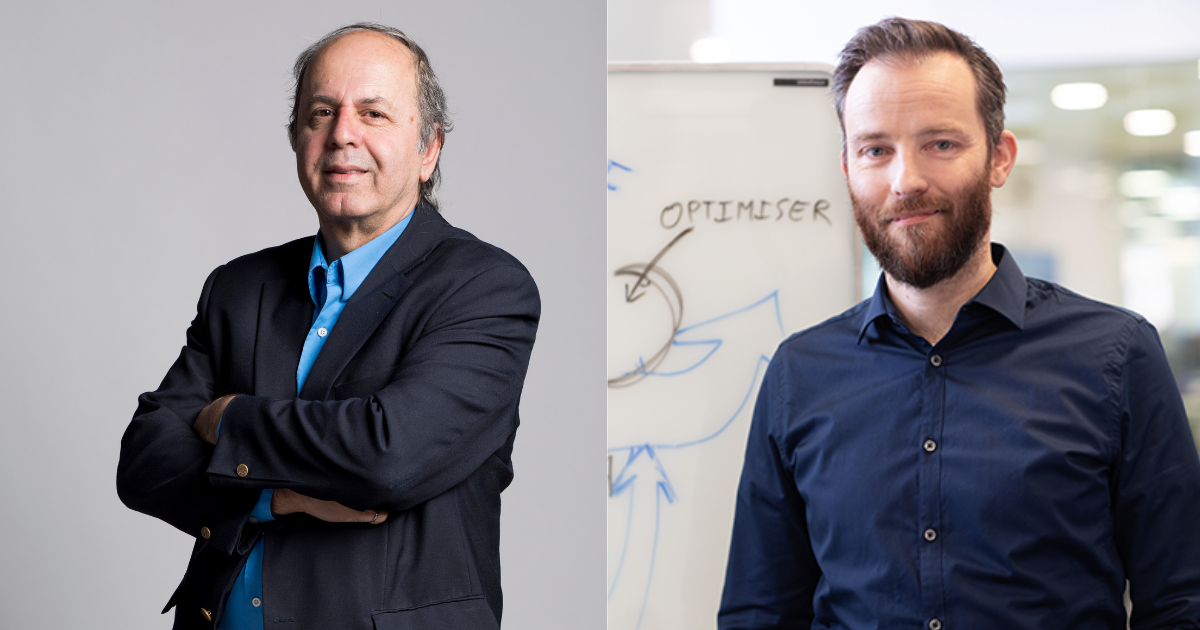Résumé
Cet article présente la démarche de conception et de fabrication d’une prothèse de hanche biomimétique à faible rigidité. Cette démarche est basée sur les structures métalliques poreuses et les technologies de fabrication additive. Le concept proposé a été soumis aux simulations numériques et aux essais expérimentaux et présente une flexibilité accrue qui se rapproche de celle des os.
Mise en contexte
Une prothèse de la hanche est principalement composée d’une tige fémorale, d’un joint sphérique et d’une coupole acétabulaire visant à compléter le joint sphérique (voir la figure 1). Généralement, la tige fémorale est fabriquée à partir de métaux biocompatibles. Cependant, les métaux étant plus rigides que les os humains, l’utilisation d’une prothèse métallique mène à la distribution non uniforme de chargements dans le fémur (le phénomène est communément appelé « bouclier de contrainte » en français ou « stress shielding » en anglais). Un tel phénomène cause invariablement une résorption ou perte osseuse dans la partie du fémur entourant l’implant. À long terme, cette perte de tissu osseux peut conduire à la fragilisation du fémur et à l’apparition de fissures engendrant le besoin d’une intervention de remplacement de la prothèse (Beaupré, Orr et Carter, 1990; Ridzwan et al., 2007). Ces interventions impliquent des soins majeurs et une convalescence prolongée des patients.

Selon le Registre canadien des remplacements articulaires et de l’Institut canadien d’information sur la santé, le nombre de remplacements des prothèses de la hanche a plus que quadruplé au cours des 10 dernières années (ICIS, 2004; 2014). Dans les faits, l’Institut Calot (France) témoigne que la durée de vie d’une prothèse totale classique de la hanche varie entre 15 et 25 ans (Cazenave, 2011). En considérant le facteur du vieillissement de la population et le fait que des personnes de plus en plus jeunes subissent une arthroplastie de la hanche (intervention chirurgicale de l’implantation d’une prothèse de la hanche), il est impératif d’améliorer la compatibilité mécanique de la tige fémorale en ce qui a trait à la raideur du fémur (Gard, Iorio et Healy, 2000).
Ce problème d’ingénierie a fait l’objet d’un projet de fin d’études au baccalauréat en génie mécanique à l'École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) à la session d’hiver 2015. L’équipe mandatée pour ce projet était formée de quatre étudiants finissants au baccalauréat en génie mécanique : Bruno Jetté, Guillaume Fréchette, Robin Gaudreau et Olivier Guillemette. Ce projet a été supervisé par les professeurs Patrick Terriault et Vladimir Brailovski du Département de génie mécanique de l’École de technologie supérieure (ÉTS) et codirecteurs du Laboratoire sur les alliages à mémoire et systèmes intelligents (LAMSI). M. Brailovski est également titulaire de la Chaire de recherche ÉTS sur l’ingénierie des procédés, des matériaux et des structures pour la fabrication additive (CIFA).
Conception et résolution
Concrètement, l'objectif du projet visait la conception d'une tige fémorale ayant une flexibilité comparable à celle d'un fémur. À cet effet, l’approche de conception de la prothèse a été effectuée en fonction d’un procédé de fabrication additive.
La stratégie a consisté en la modélisation d’un assemblage « tige fémorale -- fémur » qui manifeste les mêmes déplacements qu’un fémur intact lorsqu’il est soumis à un chargement typique. Une telle comparaison permet de globaliser la flexibilité de l’assemblage « tige fémorale – fémur » et de la comparer à celle d’un os sain. Nous nous sommes limités à un seul cas de chargement, soit l'action de la descente des escaliers, afin d'évaluer le concept. Ce mouvement commun et répétitif s’avère particulièrement important dans la sollicitation de la hanche (Bergmann et al., 2001; Morlock et al., 2001). Bien entendu, ce chargement a tenu compte de la masse d’un patient hypothétique dont les caractéristiques (taille et masse) ont été établies en fonction des modèles 3D du fémur et de la tige fémorale correspondante (voir la figure 2) (Heiner et Brown, 2001). À titre informatif, une taille de 1,83 m (6 pi) et une masse de 100 kg (220 livres) sont les valeurs retenues pour caractériser le chargement du patient type.

Des simulations numériques ont été créées avec le logiciel ANSYS Workbench 15 afin d’évaluer et de comparer les différents déplacements en fonction du chargement, et ce, autant pour le fémur intact que pour l’assemblage « tige fémorale -- fémur ».
Une structure cellulaire ordonnée à porosité ouverte a été modélisée dans la partie centrale de la tige fémorale (voir la figure 3).

D’une part, cette structure poreuse devrait permettre de diminuer la raideur de la tige fémorale et ainsi d’atteindre un comportement mécanique de l’assemblage « tige fémorale -- fémur » similaire à celui d’un fémur intact. D’autre part, elle devrait permettre l’incroissance osseuse (ostéointégration). Ceci signifie que la masse osseuse se formerait à l’intérieur des interstices de la structure poreuse de la tige fémorale et permettrait ainsi une meilleure fixation de la tige dans le fémur comparativement aux tiges conventionnelles entièrement denses. Par le fait même, cela permettrait d’éviter l’utilisation d’un ciment ou d’un liant polymérique entre la tige et la cavité osseuse.
Fabrication du prototype
La tige fémorale modélisée a été fabriquée avec le procédé de fusion sélective par laser sur lit de poudre métallique (SLM). La machine utilisée est l’EOSINT M280 du laboratoire de fabrication additive de l’ÉTS. Le matériau de base utilisé est l’alliage biocompatible EOS Cobalt-Chrome MP1.

Évaluation du prototype
Des simulations structurales numériques ainsi que des essais mécaniques analogues ont été réalisés afin de valider la diminution de la rigidité visée. À cet effet, les essais mécaniques ont permis de caractériser la relation entre la déformation globale de la tige fémorale et un chargement d'expérimentation (voir la figure 5).

Les résultats des essais mécaniques et des simulations numériques ont permis de mesurer une amélioration de la flexibilité de la tige fémorale grâce à l’utilisation de la structure poreuse. Techniquement, la valeur cible à atteindre correspondait à un déplacement global du point d’application de la charge sur la tête fémorale du fémur intact de 0,58 mm. Dans les faits, la réponse mécanique obtenue avec la tige fémorale contenant la structure poreuse a permis d’atteindre des déplacements en deçà de 3 % de la cible, soit un déplacement de 0,56 mm. Inversement, le modèle numérique d’une tige fémorale sans structure poreuse, qui est donc complètement dense, obtient des déplacements inférieurs à 25 % de la cible, soit un déplacement de 0,43 mm. La comparaison de ces configurations de modèles de chargement est illustrée à la figure ci-dessous.

Observations et conclusions
En somme, le prototype de la tige fémorale fabriqué et évalué a permis de mettre en évidence le potentiel des procédés de fabrication additive en dehors de la liberté de fabrication des formes géométriques complexes. En d’autres termes, la fabrication additive a permis d’atteindre un comportement mécanique spécifique et ciblé en intégrant une structure architecturée dans une pièce à géométrie complexe.
Il est à noter que l’utilisation de matériaux moins rigides que l’alliage de Cobalt-Chrome devrait permettre d'améliorer davantage la flexibilité de la tige fémorale. À cet effet, une modélisation par éléments finis utilisant un alliage de titane intégrant la même structure poreuse que celle utilisée a permis de valider une telle hypothèse.
La prochaine étape dans le raffinement du design de la tige fémorale correspond à l’optimisation des dimensions, de l’orientation et de la distribution de pores dans la structure afin d’homogénéiser la distribution de charges entre la tige fémorale et le fémur. Une telle méthode d’optimisation structurale en fonction de l’uniformisation de la distribution de charges exige l’utilisation d’un algorithme d’optimisation topologique.