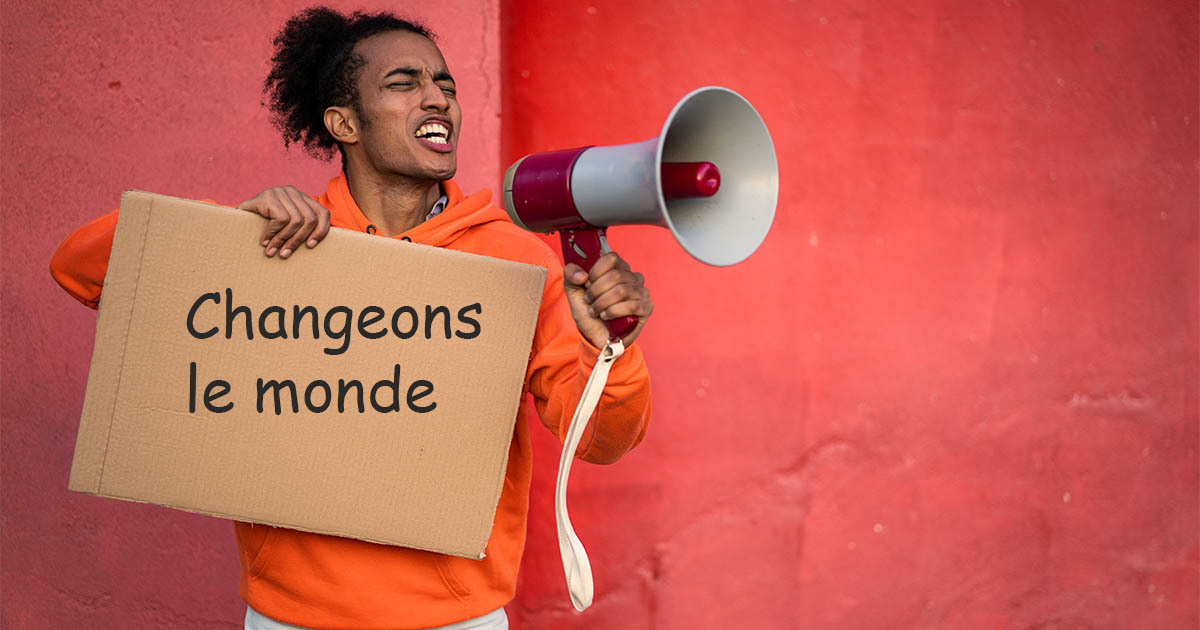Le consentement sexuel s’inscrit au cœur des relations saines et respectueuses. Pourtant, il reste souvent entouré de mythes, d’idées préconçues et d’une communication parfois insuffisante. Comprendre et appliquer le consentement dans nos vies est essentiel, non seulement pour prévenir les abus, mais aussi pour favoriser des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects du consentement et déconstruirons certains mythes.
Les bases fondamentales du consentement
Le consentement doit être libre, éclairé, enthousiaste et réversible. Cela signifie que chaque personne impliquée dans une relation sexuelle doit être en mesure de dire « oui » sans pression, tout en étant pleinement informée des circonstances. Le consentement doit être donné de manière active : le silence ou l’absence de résistance ne sont pas des signes de consentement et ne doivent pas être interprétés comme un accord implicite. Surtout, il est révocable à tout moment. L’idée principale est que chaque individu doit être acteur de ses choix sexuels et avoir la liberté de fixer ses propres limites.
Malheureusement, des malentendus persistent autour du consentement. L’un des plus courants est qu’au sein d’une relation amoureuse, le consentement est implicite. En réalité, vérifier continuellement le consentement, même au sein d’une relation établie, est une marque de respect et de communication ouverte.
Les stéréotypes de genre et leurs conséquences
Les stéréotypes de genre jouent un rôle néfaste dans la compréhension et l’application du consentement. Un mythe persistant est que les hommes doivent toujours être prêts pour une relation sexuelle, qu’ils ne peuvent pas dire « non » ou qu’ils ne subissent jamais de pression sexuelle. Ces idées contribuent à une culture où les hommes peuvent se sentir obligés de participer à des activités sexuelles, non pas parce qu’ils en ont envie, mais parce qu’ils pensent que c’est attendu d’eux.
Le consentement ne peut jamais être supposé en fonction de l'apparence ou du comportement d'une personne. Par exemple, porter une tenue jugée « sexy » ou adopter une attitude ouverte ne signifie pas qu'une personne est d'accord pour une relation sexuelle. Le consentement doit toujours être explicitement demandé et donné, indépendamment des perceptions ou des suppositions extérieures.
Il est essentiel de déconstruire les idées qui associent la sexualité à une performance ou à une obligation. La sexualité n’est pas un devoir ou une attente à remplir, on devrait plutôt la percevoir comme un choix volontaire, un plaisir partagé et un moment d’échange. Autrement dit, vous ne devez rien à personne.
Consentement et substances altérant le jugement
Un autre facteur important est l’impact de l’alcool et des drogues sur le consentement. En surconsommation, ces substances peuvent altérer la capacité à prendre des décisions éclairées et à comprendre pleinement une situation. Dans un tel contexte, il est impossible de donner un consentement valide. Il est donc essentiel de reconnaître les signes indiquant qu’une personne n’est pas en mesure de consentir et d’agir en conséquence, notamment en s’abstenant de toute activité sexuelle dans ces conditions.
Développer une culture du consentement
Pour qu'une véritable transformation des mentalités ait lieu, il est essentiel de repenser la manière dont nous abordons et discutons de la sexualité. Cela passe par la déconstruction des stéréotypes, la valorisation des émotions et la promotion d'une culture fondée sur le respect mutuel. Après tout, le consentement est bien plus qu’un simple « oui » ou « non » : c’est une manière de dire « je te respecte et je me respecte ».
Que faire si vous êtes témoin ou victime d’une situation ou le consentement n’a pas été respecté
Si vous êtes témoin
- Offrir votre aide : vérifiez auprès de la personne si elle accepte que vous l’aidiez et assurez-vous que votre intervention n’augmentera pas la dangerosité de la situation. Faites-le de manière indirecte si votre sécurité semble compromise.
- Manifester votre désaccord : faites savoir à la personne que ce comportement est inacceptable à l’ÉTS. Rappelez-lui que l’ÉTS a des politiques en matière de harcèlement et de violences à caractère sexuel.
- Soutenir la personne : dirigez-la vers des ressources. Invitez-la à communiquer avec le BRP ou à parler à une personne d’autorité en qui elle a confiance.
Si vous êtes victime
Le Bureau du respect de la personne (BRP) est là pour vous écouter, vous conseiller, vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches. Si vous ne souhaitez pas signaler la situation au BRP, vous pouvez :
- Vous confier à une personne en qui vous avez confiance.
- Demander de l’aide pour faire face aux répercussions psychologiques de la situation (SVE, Ligne VACS : Info-aide violence sexuelle)
- Documenter les événements, prendre en note les détails des incidents et conserver tout élément de preuve.
Ressources
- Bureau du respect de la personne (BRP) : brp@etsmtl.ca
- Services à la vie étudiante : sve@etsmtl.ca
- Ligne VACS
- SOS Violence Conjugale : 1 800 363-9010
Lysabel Raymond
Stagiaire en sexologie aux Services à la vie étudiante
lysabel.raymond@etsmtl.ca